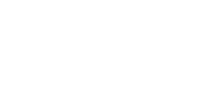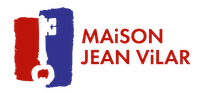Laure Adler
Julia, vous qui avez eu la chance de travailler avec elle, est-ce que vous pourriez nous introduire dans son imaginaire et nous expliquer comment il pouvait être à la fois créateur et organisé ? Certains critiques ont dit qu’Agnès Varda, c’est Agnès Varda, que ça fait beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, mais qu’au niveau de la conception scénaristique de ses films, c’était un peu des associations d’émotions, de pensées, d’images, qu’une idée en entrainait une autre. C’est peut-être finalement ce qui définit son art ? Vous évoquiez tout à l’heure Les plages d’Agnès ; quand on revoit le film, ça commence sur une plage, avec des miroirs, et à partir de ce jeu de miroirs et de la mer qui est juste à côté, va s’organiser quelque chose qui va permettre à Agnès Varda de construire un récit. Et ce récit va devenir de plus en plus autobiographique. Si on prend cet exemple concret et précis, pouvez-vous nous dire comment son travail s’articulait et comment il était composé ?
Julia Fabry
Je ne suis pas d’accord avec cette idée que le talent d’Agnès était essentiellement dû ou construit à partir d’un esprit d’escalier ; on a beaucoup dit que la figure de style qui consiste à « passer du coq à l’âne » était son talent, c’est vrai mais c’est complètement restrictif pour moi… c’est pas du tout structurel. Je reparlerai des Plages parce que c’est un des films que je connais le mieux puisque c’est le premier sur lequel on a collaboré.
Mais avant de parler des Plages, je prendrai juste un ou deux exemples, que ce soit Cléo de cinq à sept, avec une construction basée sur le temps, ou La pointe courte et son montage en alternance. Mais je voulais rebondir sur ce que disait Dominique, parce que dans le travail d’Agnès il y a une relation au temps qui est extrêmement particulière, dans sa vie et dans la construction de son œuvre. Par exemple dans l’idée, d’une certaine façon gigogne, du triptyque, de cette vie en trois parties : d’abord photographe, ensuite cinéaste, enfin plasticienne, en tout cas « visual artist » parce qu’elle n’aimait pas ce terme de plasticienne.
Dans la construction de ses œuvres il y a toujours cette idée des trois temps qui revient puisqu’elle aimait beaucoup la forme du triptyque, et dans ses films il y des constructions qui sont extrêmement précises, avec une réflexion antérieure à la réalisation de l’œuvre qui est excessivement pragmatique et puissante. Dans Sans toit ni loi il y a vraiment une construction d’alternance entre ce qu’on peut imaginer être un documentaire mais qui n’en est pas un, qui est totalement « fictionnalisé », avec ces témoignages de gens, face caméra qui vont reconstituer le portrait de cette femme qu’ils ont croisée, et les moments de récit dits « classiques » du parcours de cette vagabonde, qu’elle avait déterminés très précisément. L’écriture cinématographique est ciselée et ponctuée de sept travellings , accompagnés par la musique de la compositrice Joanna Bruzdowicz dans La pointe courte en 54, cette structure qui va finalement définir tout son travail, entre documentaire et fiction, est installée. Là encore elle alterne un récit concernant d’une part des pêcheurs, la communauté du quartier de la Pointe Courte qu’elle connaît très bien depuis sa jeunesse, interprétée par des non acteurs, les gens du réel, et une fiction absolue en choisissant deux acteurs du TNP de Jean Vilar, Silvia Montfort et Philippe Noiret qui, très théâtralisés, se placent du côté de la fiction. Donc une structure en alternance là aussi qui est très forte.
C’est compliqué de dire que le travail d’Agnès est limité au maniement du coq à l’âne , mais je crois qu’on lui a associe cette image en raison de sa grande inventivité au moment du montage. Il y a dans le travail d’Agnès toute cette appréhension du réel à travers la caméra et le cadre puisqu’elle vient de la photographie, mais il y a ensuite tout ce travail d’agencement et de construction avec une virtuosité d’association d’idées qui arrive au moment du montage ; ça c’est indéniable.
Laure Adler
Oui, dans Varda par Agnès, elle expliquait avec une grande précision et une grande rigueur à quel point effectivement il y a un côté conceptuel dans son travail, et notamment dans Sans toit ni loi. J’imagine bien qu’Agnès Varda, et tout le monde le sait, a écrit des scénarios avant de prendre la caméra.
Mais alors, comment son imaginaire rentrait dans sa rigueur ?
Julia Fabry
Alors, c’est effectivement par le réel, je pense, que l’imaginaire rentrait dans sa rigueur parce qu’Agnès avait l’habitude de dire que son meilleur assistant, ça n’était pas moi, c’était le hasard et c’est ce que l’on retrouve très souvent dans la construction des films, qu’elle savait conserver aussi à postériori, c’est-à-dire l’entrée du réel dans ce qu’elle avait déjà préparé.
On a énormément d’exemples qui vont dans ce sens-là, il y en a un qui est magnifique, qui, moi, me touche beaucoup parce que c’est mon film préféré d’Agnès : Documenteur, où elle filme l’histoire d’une séparation entre un homme et une femme. C’est Sabine Mamou sa monteuse, qui n’était pas actrice, qui interprète cette femme et dont le fils est lui interprété par Mathieu Demy, le fils d’Agnès dans la vie. On suit cette femme solitaire dans Los Angeles très noir. À un moment, elle est dans une cabine téléphonique, et tout d’un coup il y a du réel qui surgit à travers une dispute vraiment très violente entre deux personnes, dans la rue où Agnès est en train de filmer cette scène. C’est une dispute tellement violente que Sabine Mamou est un peu dérangée dans son jeu, donc ne sait pas trop comment agir, elle regarde Agnès, et sa chef opératrice Nurith Aviv (avec qui elle aura plusieurs collaborations) qui avait la capacité de suivre l’instinct d’Agnès. Agnès lui demande de continuer à tourner et cette scène du réel va s’inclure complètement dans la fiction, comme une métaphore de tout le film et prendre même toute la place de cette scène. Agnès, c’est justement là que c’est très intéressant, saura lui donner une très grande place en l’accompagnant d’une musique de Georges Delerue qui est une musique très mélancolique et très dramatique et qui permet finalement de mettre un peu plus en lumière ce réel qui surgi au milieu de la fiction à un moment où elle, elle était dans la construction propre de son récit.
C’est vrai que Les plages est un très bon exemple aussi pour évoquer toutes ces questions parce que l’idée de se raconter à travers cinq plages de sa vie, montre son souci de structure. Elle avait déterminé ces plages puis commencé à poser sur le papier des idées qui étaient en lien avec ces lieux et les moments différents de sa vie. Il n’y avait pas vraiment de chronologie car ça ne l’intéressait pas mais un fil conducteur qui était la plage et qui reste une inspiration importante dans son travail. Là aussi sur le papier il y avait une structure en cinq temps et puis au moment du tournage, il y a eu les rencontres, les impromptus, les idées, les possibles qui surgissaient tout d’un coup du réel et qu’Agnès avait cette capacité d’inclure instantanément.
Dominique Bluher
Je voudrais rebondir sur deux trois choses que tu as dites. Oui, le réel c’est peut-être l’exemple le plus simple. Si on revient à Cléo de cinq à sept, quand Cléo quitte sa maison, elle enlève sa perruque et elle rencontre un homme qui avale des grenouilles, et elle s’arrête. Bon, là c’est une fiction, mais ce qu’elle a filmé c’était du réel. Je ne sais pas comment s’est effectivement passé le tournage mais peu importe, l’important c’était de s’arrêter, de s’émerveiller, et d’inclure ça. On peut évoquer plein de moments, où Agnès se permet la digression, d’être ouverte au hasard, à quelque chose d’imprévu et de faire la place pour ça dans ses films. Ou dans Les glaneurs et la glaneuse, cette séquence complètement superflue, si on veut, quand elle a, par mégarde, laissé traîner la caméra et qu’il y a le petit bouchon qui sautille. C’est par hasard qu’elle trouve ça pendant le montage, et ça n’a pas été éliminé, ce petit moment fait partie du film. Quelque chose qui à priori n’est pas un apport narratif, n’instruit pas grand-chose, mais qui dit énormément. C’est pour moi là aussi que se situe l’art d’Agnès, dans ces moments qui sont tellement anodins, banals et la manière de les intégrer : ça peut devenir une métaphore, comme ce petit bouchon peut devenir la métaphore pour tout ce qu’on jette, que ce soient les pommes de terre, ou ce qu’on met à l’écart de la société ; ce petit bouchon aurait pu partir à la poubelle au moment du montage, mais il prend sa place et devient quelque chose qui se remplit de petits signes qu’elle a semés tout au long de ses films, et se chargent de quelque chose qui peut nous parler.
La dernière chose que j’aimerais ajouter c’est son don de la parole, son don d’écrire un commentaire qui soit allègre, léger, mais aussi rigoureux… Donc le coq à l’âne, moi non plus, je ne suis pas d’accord avec ce concept de quelque chose de trop facile ; c’est très difficile de faire du bon coq à l’âne ! C’est un art qu’elle a dû travailler énormément au montage, en plaçant les mots de manière à laisser respirer les images, en injectant quelques mots qui résonnent, qui font écho, qui élargissent la signification de l’image, puis faire rebondir autre chose, et ça continue, ça continue… C’est un bonheur pour l’enseignant qui peut expliquer ça à ceux qui n’auront pas tout de suite compris.
Laure Adler
Macha, on parlait du réel, comment voyait-elle le réel selon toi et quels étaient vos secrets d’atelier ?
Macha Makeïeff
Je voudrais revenir sur le sujet du hasard. Le hasard, chez Agnès, c’est le hasard objectif, c’est celui des surréalistes. C’est-à-dire que ça n’existe pas s’il n’y a pas une très longue, très profonde préméditation. Le hasard ne va advenir, ce hasard que l’on cherche pour l’œuvre d’art, ne va advenir que si on travaille énormément en amont ; les surréalistes ne s’y trompaient pas, eux qui avaient derrière leur soi-disant indiscipline une rigueur absolue qui allait jusqu’au manifeste. Chez Agnès il y a ça, qu’on ne s’y trompe pas ! Oui, elle joue avec la discipline comme ça, elle dit « Regardez, j’ai ramassé une chose ! Vous avez vu c’est formidable, elle était là, à mes pieds »…tu parles Charles ! C’est toute une vie pour trouver ça à ses pieds, ce n’est pas par hasard du tout, ce hasard-là. C’est parce que vous vous êtes rendue tellement disponible au monde, disponible à ça. C’est une posture poétique profonde de chaque instant. Alors évidemment ça arrive, mais je vous assure, c’est beaucoup de travail, c’est beaucoup d’abnégation, c’est un rapport au monde, au réel, presque mystique. Oh, je sais qu’elle n’aimait pas ce mot là, moi je le prends ! Je sais bien, ces choses-là ne vous sont pas données, c’est une attente longue, l’avaleur de grenouilles, il n’est pas sur votre chemin comme ça ; il faut savoir que sur les places publiques il y a des gens comme ça, il faut y être venu, revenu, regarder, observer, espérer, alors après ça advient. Mais derrière tout ça il y a une grande rigueur, une grande discipline de la vie, une énergie de l’attente.
Laure Adler
Alors l’attente, effectivement, c’est un concept philosophique un peu marginalisé aujourd’hui. Une philosophe qui s’appelait Jeanne Hersch, avait conceptualisé l’attente comme principal rapport au monde ; est-ce que pour vous, Julia, Agnès attendait? Est-ce qu’elle attendait ou alors est-ce qu’il y avait tellement de choses intéressantes dans le monde, dans une fraction de seconde, quand elle ouvrait les yeux, et vous avez évoqué tout à l’heure son énergie, son appétit, ses désirs, sa sensualité, son énergie considérable, c’était une gourmande de la vie… mais alors, est-ce que c’était plutôt une attente pour essayer de décrypter quelque chose qu’elle pourrait transformer artistiquement, ou c’était le réel plutôt qui débordait, qu’il fallait qu’elle l’organise ?
Julia Fabry
Il est assez facile de répondre à cette question parce qu’Agnès n’était pas du tout dans l’attente, et dans le travail c’était même assez compliqué parce qu’elle était toujours en avant d’abord, en avant de tout, en avant d’elle-même, en avant des idées, en avant d’un évènement, c’était compliqué de la suivre parce qu’elle était toujours en avance, mais au sens littéral du terme et là je ne faisais absolument rien pour changer cette nature profonde qu’elle avait, depuis l’enfance je crois. Je pense que c’est quelqu’un qui avait pris l’habitude de devancer les choses. J’ai eu l’occasion d’avoir énormément de sujets de conversation autour de sa famille parce que c’était un sujet qui me passionnait et il semblait qu’elle l’avait un petit peu relégué au second plan de sa création en tout cas et de sa vie, et il apparaissait de manière assez évidente qu’elle s’était déjà préparée à devancer certaines choses, y compris, dans certains évènements de sa vie, donc dans le travail, je le redis, c’était beaucoup d’énergie, beaucoup d’urgence. Ça n’était pas je crois une urgence qui était due dans les dernières années de sa vie à une urgence créatrice d’accomplir des choses qu’elle avait envie d’accomplir parce que j’ai le profond sentiment que c’était sa nature et qu’elle était dans cette urgence-là très, très jeune, avec l’idée que la famille dans laquelle elle était arrivée n’était pas forcément celle qui lui convenait le mieux. Elle a fait le choix d’aller vers ce qui lui correspondrait plus dans la vie et aller au devant des idées, aller au devant des énergies ; et je dirais que si elle était dans l’attente c’était plus dans l’attente de quelque chose des autres, c’est-à-dire dans la rencontre, un élément qui motivait énormément son travail et sa création puisqu’elle était passionnée par les gens dans une interrogation permanente de qu’est-ce qu’est l’autre ? Qu’est-ce qu’il nous renvoie ? Qu’est-ce qu’il nous raconte de nous ?
Elle attendait beaucoup des gens, c’est-à-dire qu’elle avait cette capacité quand elle était face à quelqu’un d’exiger le meilleur de lui que ce soit un balayeur qu’on avait rencontré, un remailleur de filets sur un quai à Sète ou que ce soit Pierre Soulages chez lui au sujet de sa peinture, elle avait cette capacité d’attendre énormément des autres et qu’ils le lui rendaient bien parce que moi j’ai toujours été émerveillée des réponses que les gens lui apportaient dans ces rencontres-là qui avaient souvent une dimension extraordinaire. Mais parce qu’elle avait cette capacité-là, je crois, de faire confiance à l’autre et dans le regard qu’elle portait sur les gens de leur dire d’emblée : « Je sais que ce que tu vas me dire va être passionnant ».
Dominique Bluher
Nous deux, sommes peut-être trop jeunes pour avoir connu des moments où Agnès a dû être en attente. Nous, on est venues dans sa vie, dans son œuvre, après Les glaneurs, mais je peux imaginer qu’il y a eu des moments d’attente impatients ; parce qu’elle avait du mal à monter ses films, à trouver l’argent, des scénarios refusés, et tout ça c’était avant mon époque. Moi j’ai connu une Agnès comme la décrit Julia, avec qui c’était extrêmement difficile de trouver un rendez-vous, extrêmement difficile de trouver les dates pour faire une exposition, extrêmement difficile parce qu’il y avait tellement de choses à faire, et plus elle vieillissait, plus elle était dans cette urgence de faire. Mais ce qui est merveilleux c’est qu’elle ait pu faire ça ; il faut quand même dire, ce n’est pas donné à tous les artistes de pouvoir travailler jusqu’au dernier jour. Elle a fini ce qu’elle voulait finir, les deux derniers films qu’elle voulait faire après Les plages. Elle a eu aussi la chance inouïe d’avoir la force de pouvoir faire ça, et très bien accompagnée par Rosalie, par Julia, par tous les autres de son équipe qui étaient là pour son urgence.
Julia Fabry
Si on remonte aussi loin qu’on peut remonter, je suis remontée un peu à son enfance par des conversations qu’on a eues ensemble, dans sa création il est peut-être intéressant de rappeler que quand elle commence La Pointe Courte en 54 elle n’a pas vu de film, elle n’est pas cinéphile du tout, elle n’a pas fait d’études cinématographiques, elle a commencé avec Jean Vilar de la même manière. Elle s’occupait des enfants de Vilar à Sète et il lui dit : « Viens participer à l’aventure et faire des photographies », donc elle arrive et tout de suite elle devient photographe officielle du TNP, là, vraiment sans attendre non plus.
Chaque train qu’il a fallu prendre en marche, Agnès était déjà sur le quai d’une certaine manière et elle tourne le film La Pointe Courte sans réfléchir ; elle va chercher un monteur qui est Alain Resnais pour l’aider parce qu’elle ne sait pas comment faire le montage, qui lui dit : « Votre sujet est trop proche de ce que je voudrais faire moi, donc je ne veux pas m’en occuper », puis quand il voit la fulgurance avec laquelle elle applique, les trois conseils qu’il lui a donnés et qu’Agnès en 48 h a déjà monté les trois quarts de ce qu’il lui a donné comme exercices, il expliquera : Je me suis incliné par rapport à cette volonté acharnée et j’ai décidé de l’aider, par respect et par admiration, déjà d’un travail accompli dans une durée qui était complètement incroyable par rapport à ses capacités et à son savoir. Un autre exemple : quand en 1967 elle arrive à Sausalito, une banlieue de San Francisco, elle rencontre quelqu’un dont on lui dit qu’il est de sa famille, c’était oncle Yanco, ça donnera le court-métrage Oncle Yanco, elle va à la rencontre de cet homme dont elle comprend qu’ils ont vraiment un lien familial (d’une certaine manière, pour moi, cette personne va lui donner une légitimité artistique car il était le premier membre de sa famille auquel elle peut s’identifier), elle n’a pas de moyen de financement, elle a trois jours devant elle, elle décide de trouver un chef opérateur dans l’école la plus proche, de trouver de la pellicule 35 mm, en trois jours c’est plié et ça donne un bijou. Des exemples comme ça il y en a beaucoup. Je pense qu’il n’y a jamais eu d’attente
Macha Makeïeff
Je parlais d’attente non pas comme d’une inertie, elle n’attendait pas Agnès, elle n’attendait jamais et comme tu dis très justement elle était avant vous, tout le temps. Non, non, c’est une façon d’être au monde, une tension. Elle savait que les choses allaient advenir et elle se rendait disponible. Elle était en face de quelqu’un, et les choses advenaient parce qu’elle était dans cette tension. Je pense que ça, ça suscite le meilleur de l’autre qui est en face ; elle avait un sens de l’altérité incroyable. Je n’ai pas d’autre exemple d’artiste qui soit autant dans l’altérité et pourtant nous, au théâtre, sommes tout le temps dans ce face à face avec l’acteur, puis après avec les spectateurs, et elle c’était dans la vie réelle, concrète, comme ça sans aucun protocole. S’asseyant en face de toi, elle disait : « Je t’ai apporté des poissons, qu’est-ce que tu en penses ? »
C’est vrai, à La Criée, que monter les trois étages de la Fabrique avec une brassée de poissons ruisselants c’est une image définitive. C’est de l’ordre d’un don incroyable, ces poissons dans ce théâtre, avec la malice que ça suppose parce que ce théâtre s’appelle La Criée. Monter les trois étages pour dire « Tu vois, je te les ai apportés les poissons, ça a du sens que tu sois là, on a des poissons entre nous ». C’était ça Agnès, cette espèce de tension vers l’autre qui suscitait quelque chose de très décalé et de beaucoup plus intelligent que ce qu’on pourrait croire. C’est aussi profond que les surréalistes, attraper les choses et leur donner du sens par des associations étonnantes qui supposent le chemin parcouru. C’est une très longue préméditation, un très long regard sur le monde et sur les autres qui avait précédé. C’est ce qui me touche chez cette artiste, vraiment.
Dominique Bluher
Je le formulerais un peu différemment, mais pour moi c’est tout à fait similaire. Elle a une intelligence, pour nous qui sommes très verbeux, qui essayons d’intellectualiser, qui est très difficile à expliquer justement. Ce qu’Agnès était capable de faire, ce n’était pas avec une intelligence intellectuelle. Elle était dans la matière, dans l’association, dans la surprise, dans la tension. Moi, je suis en difficulté pour trouver les mots qui résonnent juste avec son art.
Laure Adler
Aujourd’hui même est inaugurée une exposition à Paris, à la Fondation Cartier, où il y a la dernière œuvre d’Agnès Varda. Cette œuvre a été accompagnée d’un texte d’Agnès assez bouleversant. Pour la première fois, je crois, elle parle de sa haute enfance, elle parle de la forêt et de sa peur dans la forêt quand elle était petite fille. J’avoue que j’ai été saisie d’une émotion incroyable en lisant ce texte qu’elle a composé très peu de temps avant sa disparition.
Donc Agnès, elle est toujours là. Je voudrais ajouter que c’était une grande perturbatrice, en tout cas pour moi. La dernière fois que je l’ai vue, j’étais avec Dominique (Bluher) dans sa maison rue Daguerre, elle m’avait dit en maugréant : « Viens vers 10 heures et demi, c’est un dimanche, tu resteras une heure, viens prendre un café et après tu t’en iras», et jusqu’à minuit on s’est pas quittées parce qu’elle avait décidé qu’il fallait rester ensemble, et cætera. Cette manière de perturber l’emploi du temps, de perturber le rapport au monde, de désorienter les êtres… elle était très exigeante.
J’admire Julia d’avoir vécu avec Agnès parce qu’il fallait être toujours en tension avec elle et j’avais toujours l’impression de ne jamais être au quart du niveau du millième de sa hauteur. Et en même temps, quand on la quittait on était encore plus triste parce qu’on se disait : « merde, on est encore plus bas que le plus bas ».
Que va-t-il rester d’Agnès pour chacune d’entre vous ?